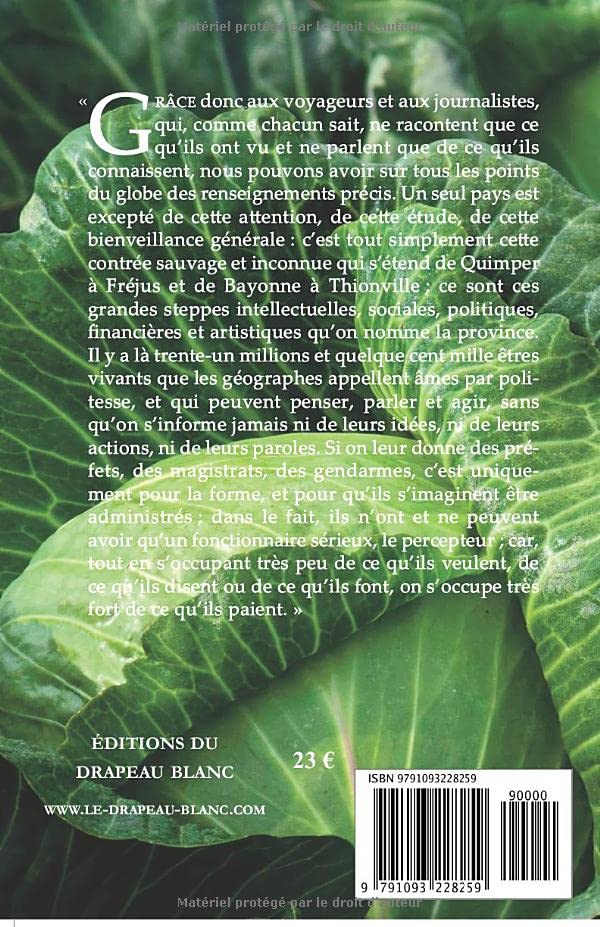Les Contes et rêveries d’un planteur de choux ont eu leur succès au XIXe siècle, mais ils sont aujourd’hui trop peu connus, malheureusement.
Le planteur de choux en question n’est autre qu’Armand de Pontmartin, critique littéraire légitimiste qui est resté fidèle aux aînés des Bourbons et n’a jamais daigné servir des princes illégitimes, préférant ainsi regagner sa province avignonnaise plutôt que de rester dans un Paris hypocrite.
Si certains critiques littéraires se contentent de critiquer, Pontmartin a mis plusieurs fois la main à la pâte, et ses Contes et rêveries constituent un modèle de style dans la confection d’un petit roman, d’une nouvelle épistolaire, de nouvelles et d’articles amusants. La « littérature officielle » ne les ont pas retenus, en voulant à leur auteur d’avoir porté des jugements sévères sur plusieurs chouchous de la modernité ; mais le lecteur du XIXe siècle constatera aisément par lui-même ce qu’il en est.
Les Contes et rêveries d’un planteur de choux comprennent le roman Napoléon Potard, la nouvelle épistolaire Marguerite Vidal, les nouvelles Les Trois Veuves ainsi que Le Bouquet de marguerites, puis – pour finir – les articles formant les Silhouettes d’artistes en province.
« — Alors, mon ami, après avoir essayé de ces chimères stériles, j’ai demandé asile à la plus séduisante de toutes, à la poésie ; j’ai terminé un drame et un volume de vers ; j’ai porté le tout à un directeur de théâtre et à un libraire : le directeur a refusé ma pièce, parce qu’il n’y avait, m’a-t-il dit, ni adultère, ni viol, ni cimetière, ni poison, ni inceste ; et le libraire a refusé mes vers, sous prétexte qu’ils n’étaient ni assez neufs, ni assez ridicules pour avoir du succès. Voilà où j’en suis de mon odyssée. »
« — Hélas ! mon fils, le bois et la caverne, aujourd’hui, c’est le monde, c’est le salon, c’est la Bourse, c’est le gouvernement, c’est le ministère ! Pour te conter une histoire de voleurs, il faudrait te faire toute notre histoire politique, industrielle et morale, et celle-là ne t’amuserait pas ; elle est déjà bien assez triste pour nous, vieux enfants, qui sommes forcés de la savoir ! »
« Grâce donc aux voyageurs et aux journalistes, qui, comme chacun sait, ne racontent que ce qu’ils ont vu et ne parlent que de ce qu’ils connaissent, nous pouvons avoir sur tous les points du globe des renseignements précis. Un seul pays est excepté de cette attention, de cette étude, de cette bienveillance générale : c’est tout simplement cette contrée sauvage et inconnue qui s’étend de Quimper à Fréjus et de Bayonne à Thionville ; ce sont ces grandes steppes intellectuelles, sociales, politiques, financières et artistiques qu’on nomme la province. Il y a là trente-un millions et quelque cent mille êtres vivants que les géographes appellent âmes par politesse, et qui peuvent penser, parler et agir, sans qu’on s’informe jamais ni de leurs idées, ni de leurs actions, ni de leurs paroles. Si on leur donne des préfets, des magistrats, des gendarmes, c’est uniquement pour la forme, et pour qu’ils s’imaginent être administrés ; dans le fait, ils n’ont et ne peuvent avoir qu’un fonctionnaire sérieux, le percepteur ; car, tout en s’occupant très peu de ce qu’ils veulent, de ce qu’ils disent ou de ce qu’ils font, on s’occupe très fort de ce qu’ils paient. Sous ce rapport même leur importance s’accroît à mesure que leurs charges augmentent, et plus le gouvernement auquel ils ont affaire est intéressé, plus ils deviennent intéressants.
» Je me trompe pourtant, et la province a un autre moyen de faire parler d’elle. Si personne n’y songe, tant qu’elle reste ce qu’elle doit être, une bonne et sage personne, une société de simples honnêtes gens, qui sont quelquefois des honnêtes gens fort simples, elle attire tous les regards dès qu’elle a l’honneur de produire un grand criminel. Qu’un Bourguignon ou un Provençal sauve un enfant à la nage, publie un bon livre, invente une charrue modèle, concoure pour le prix Montyon ou envoie à son conseil municipal de bons et dévoués citoyens, il n’en sera pas plus question que du grand Namaquois, et c’est tout au plus s’il obtiendra les honneurs du canard dans le Journal des Villes et des Campagnes ; mais qu’il s’avise d’assassiner les auteurs de ses jours, de couper en morceaux un certain nombre de ses semblables, d’empoisonner un ou plusieurs membres de sa famille, il devient aussitôt plus important que s’il était Turc, Égyptien ou Chinois, à l’instant même les grands journaux s’en emparent ; leurs immenses colonnes, qui ne sont pas tout à fait celles de l’ordre social, se remplissent du récit tragique, des préliminaires, des détails, des plaidoyers et des débats. La France entière se presse aux portes et s’accroche aux fenêtres d’un palais de justice. » — Armand de Pontmartin