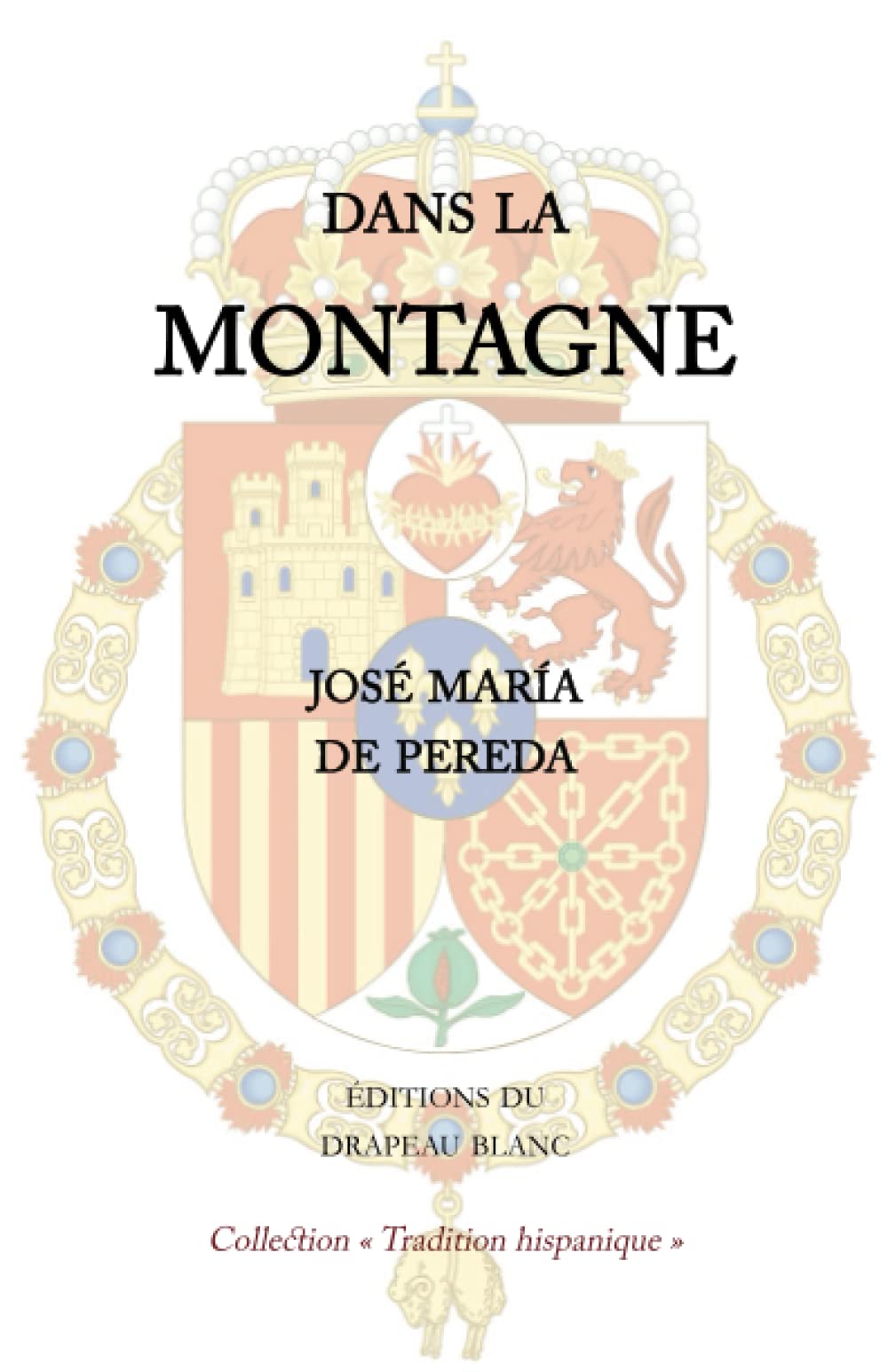Préface de René Bazin. Traduction d’Henri Collet et Maurice Perrin.
Le roman, très réaliste et non sans rapports avec l’auteur, se déroule dans la cordillère Cantabrique, dans un petit village où perdure la société traditionnelle de l’Espagne du xixe siècle, autour du curé et du petit hidalgo local. Son héritier, son neveu, arrive de Madrid pour faire connaissance avec son oncle… et les lieux, si escarpés, si enclavés. Parviendra-t-il à s’y faire ? Qu’y découvrira-t-il d’attachant ?
Un grand roman catholique et hispanique, que l’académicien René Bazin (qui s’est hâté de rencontrer, lors de son premier voyage en Espagne, José María de Pereda qui était alors en train d’écrire Dans la montagne) a salué de cette façon :
« Un critique a pu dire de Peñas Arriba [Dans la montagne], qu’une telle œuvre “enrichissait la littérature européenne”. Le jugement n’était pas une flatterie. On peut le répéter, maintenant que José María de Pereda a disparu de ce monde. Je souhaite vivement que la traduction […] se répande dans le public français ; qu’elle fasse pénétrer dans les bibliothèques de chez nous un grand livre d’un pays voisin ; qu’elle aide aussi nos compatriotes à comprendre mieux, à estimer encore plus, ce solide peuple espagnol, qu’on voit agir dans cette œuvre toute pétrie de vérité. Quand on a dit qu’il est chevaleresque, on n’a pas tout dit. »
« Si vous ouvrez Peñas Arriba, vous serez frappé du large caractère du début. C’est d’abord la dédicace : “À la sainte mémoire de mon fils, Jean Manuel”, et les mots qui suivent : “Vers le dernier tiers du brouillon de ce livre, il est une croix et une date entre deux mots. Pour l’ordinaire curiosité des hommes, ces signes rouges n’auraient pas grande importance ; et cependant Dieu et moi nous savons que, dans le misérable espace qu’ils remplissent, tient l’abîme qui sépare mon présent de mon passé.” C’est ensuite le récit de l’arrivée de Don Marcelo chez son oncle Don Celso, le vieux seigneur de la montagne. On entre dans cette histoire, comme dans la cour d’honneur d’une habitation ancienne, par un portique de haute architecture, que le temps menace, on ne le voit que trop, mais dont la ruine encore peut être relevée. Et le roman ne va pas à une autre fin : il montre ce qu’a été, ce qu’est la casa solar d’un gentilhomme de la montagne de Santander, la maison accueillante, non seulement aux pauvres, qui ne sont qu’une petite partie de nos frères, mais à toutes les familles du village, la maison conseillère et consolatrice, la maison indulgente et secourable, la maison où le prochain est aimé par la seule raison qui vaille et qui dure, l’amour de Dieu ; il nous la présente au moment où le maître, vieux et malade, va la quitter pour jamais ; il y fait revenir le dernier héritier des Ruiz de Bejos, homme du monde, homme de la grande ville ; il raconte comment, peu à peu, la montagne fait la conquête du citadin, et s’assure un nouvel ami, qui continuera l’ancien.
» La campagne aura-t-elle des riches, et quels riches l’habiteront, ou, plus exactement — car ici la richesse n’est qu’un élément secondaire —, existera-t-il une aristocratie rurale, telle qu’on l’a connue, dans les montagnes de Santander, aristocratie ouverte, cela va sans dire, soucieuse du progrès de l’agriculture et du bien-être des paysans, vivant au milieu d’eux, persuadée d’abord qu’elle a une mission d’exemple et de paternité : voilà le problème. Il n’intéresse pas seulement la province de Santander, pas seulement l’Espagne : en plusieurs pays d’Europe, le moyen ou le grand propriétaire a cessé de résider dans ses terres ; son influence a disparu ; d’autres l’ont remplacée ; il semble bien que l’expérience soit complète, et qu’on aperçoive, à sa lumière, une sorte de loi de la paix publique. Si la campagne est partagée uniquement entre des petits propriétaires et des fermiers, cette société imparfaite n’aura pas d’équilibre et sera travaillée par de terribles dissensions, car il n’y a pire jalousie qu’entre les gens à peu près égaux ; si elle est habitée par un riche qui ne soit qu’un homme politique, elle se corrompra ; si elle est habitée par un oisif, même dépensier, même généreux, elle deviendra hostile : elle ne connaîtra le repos et une certaine douceur de vivre que si une famille plus riche et plus instruite que les autres, libérale de sa fortune et surtout de son temps, fait son premier devoir de l’aimer et de la servir.
» Le romancier espagnol avait parfaitement vu l’ampleur d’un tel sujet ; il avait conscience de parler pour son pays et pour d’autres. Lorsque j’eus l’honneur d’être reçu par lui, dans sa belle villa de Polanco, en septembre 1894, il me dit, après avoir jugé ses émules avec la bienveillance et la fermeté d’un grand esprit : “Je travaille, en ce moment, à composer un livre où je peins les mœurs de la montagne, des cimes, là-haut — c’était Peñas Arriba. Mes récits ont des cadres de ce pays, mais les scènes, la psychologie, sont d’un monde bien plus étendu, et, par là, je me rattache au roman général.” »
— René Bazin dans la préface de la traduction française de Dans la montagne