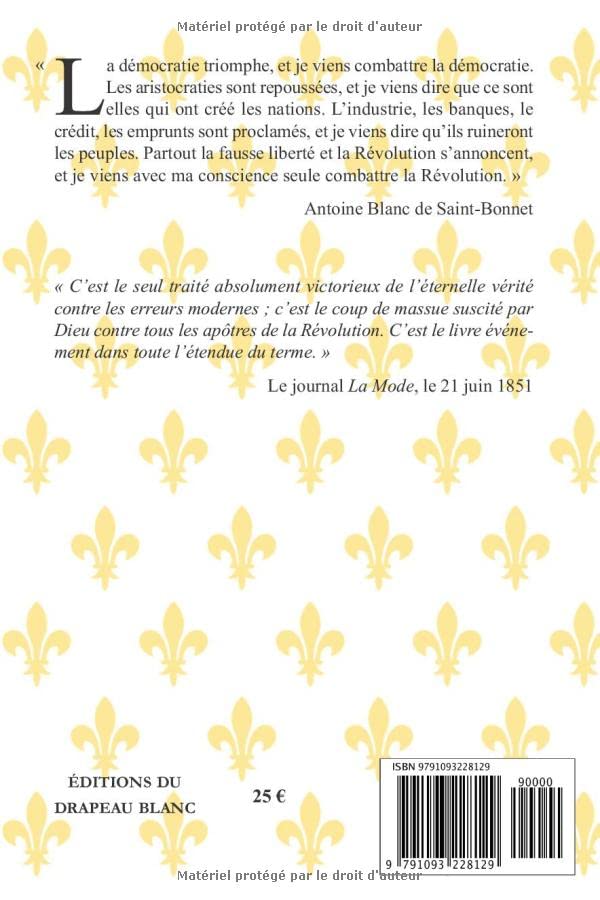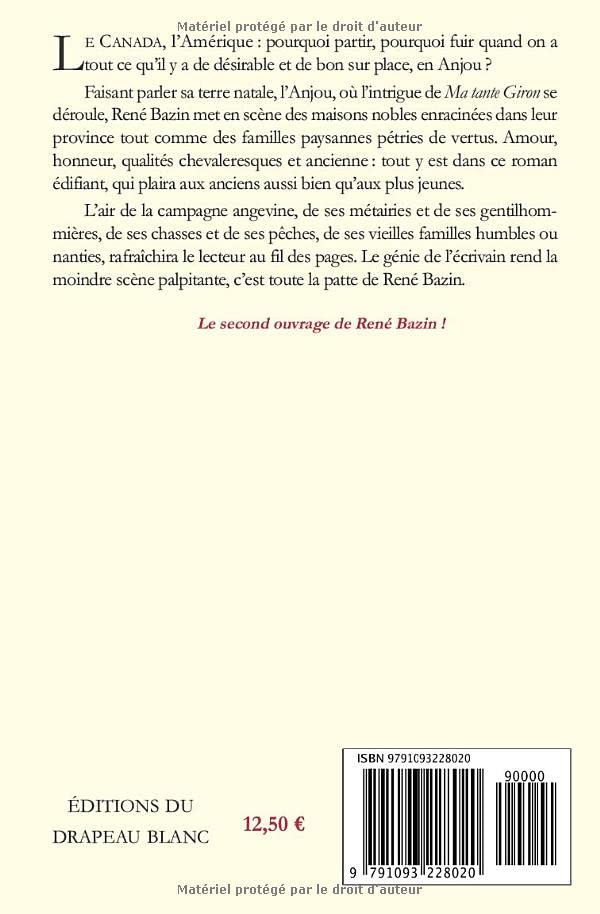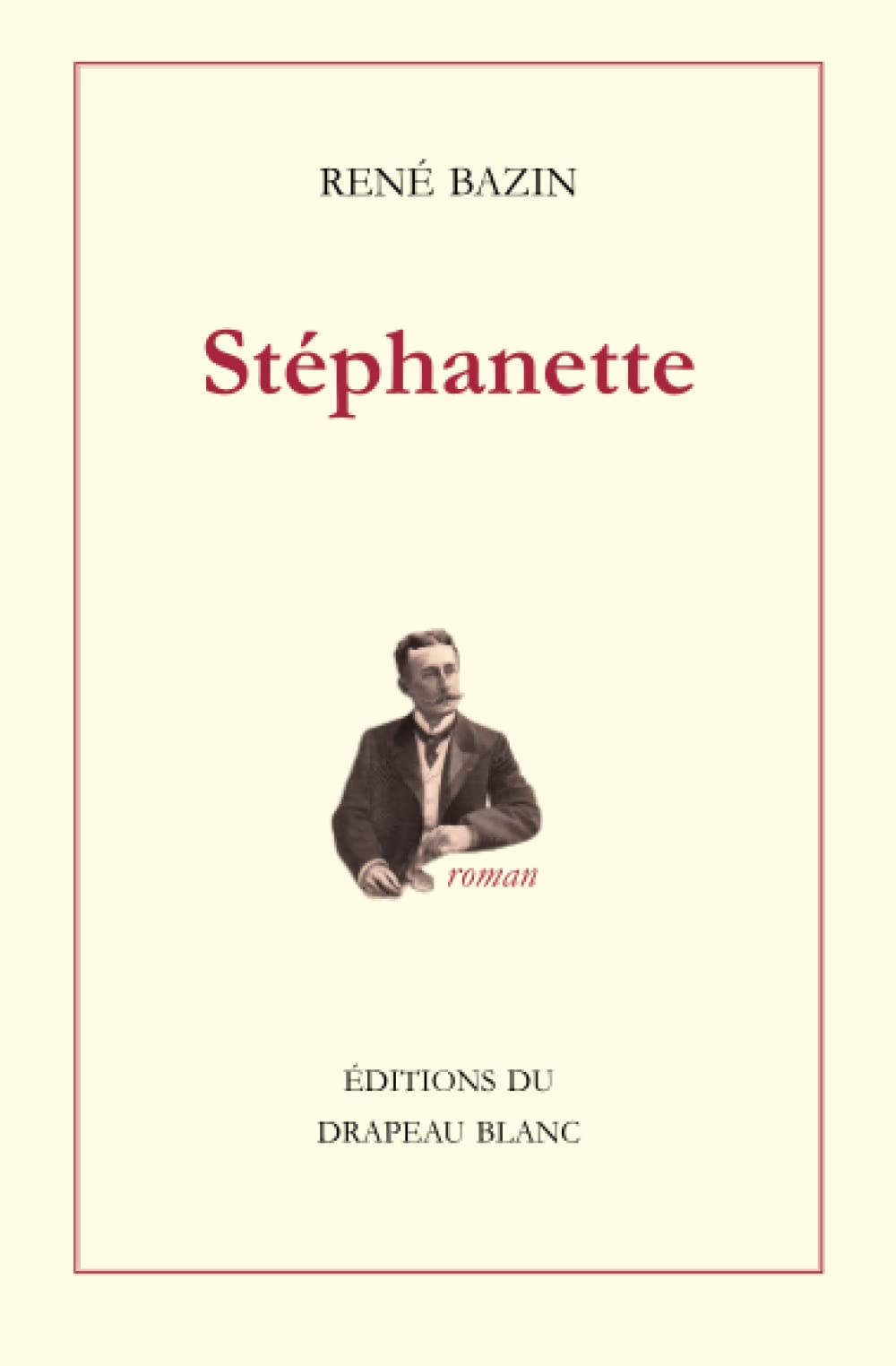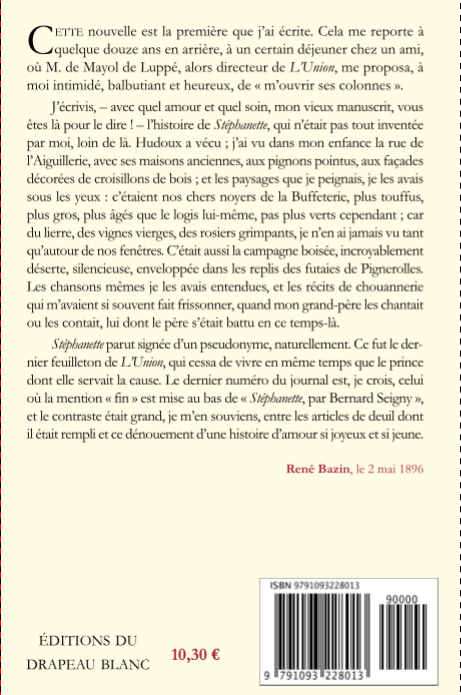Sortie à la suite de la révolution de 1848, ce livre de la Restauration française fit beaucoup parler de lui en son temps, et encore à l’occasion de rééditions, notamment après la défaite de 1870 et la Commune de Paris.
Des auteurs aussi différents que Nettement, Barbey d’Aurevilly et Baudelaire en ont fait leurs délices. Bien des pages résonnent d’une prodigieuse actualité, quand d’autres se sont avérées – malheureusement pour nous – prophétiques…
Ce livre d’économie avant l’heure, de philosophie et de politique, rédigé comme par un penseur prophète, rappellera les hommes à leurs devoirs.
« La démocratie triomphe, et je viens combattre la démocratie. Les aristocraties sont repoussées, et je viens dire que ce sont elles qui ont créé les nations. L’industrie, les banques, le crédit, les emprunts sont proclamés, et je viens dire qu’ils ruineront les peuples. Partout la fausse liberté et la Révolution s’annoncent, et je viens avec ma conscience seule combattre la Révolution » (Antoine Blanc de Saint-Bonnet).
« C’est le seul traité absolument victorieux de l’éternelle vérité contre les erreurs modernes ; c’est le coup de massue suscité par Dieu contre tous les apôtres de la Révolution. C’est le livre événement dans toute l’étendue du terme » (le journal légitimiste La Mode, le 21 juin 1851, au sujet de La Restauration française d’Antoine Blanc de Saint-Bonnet).