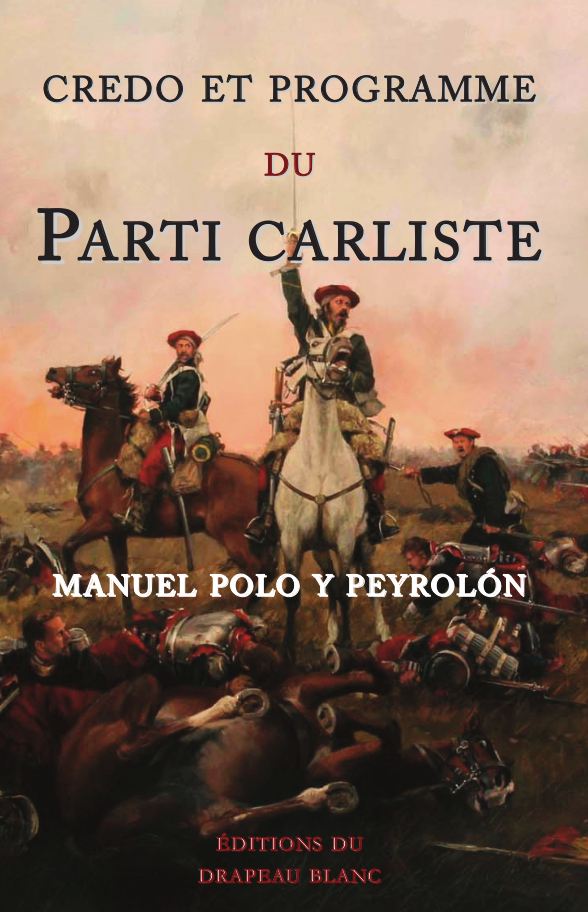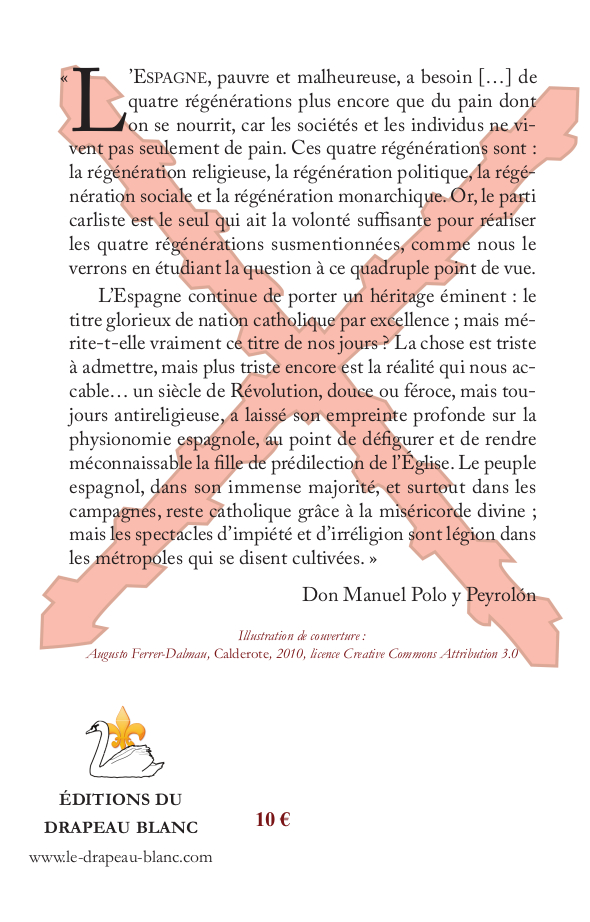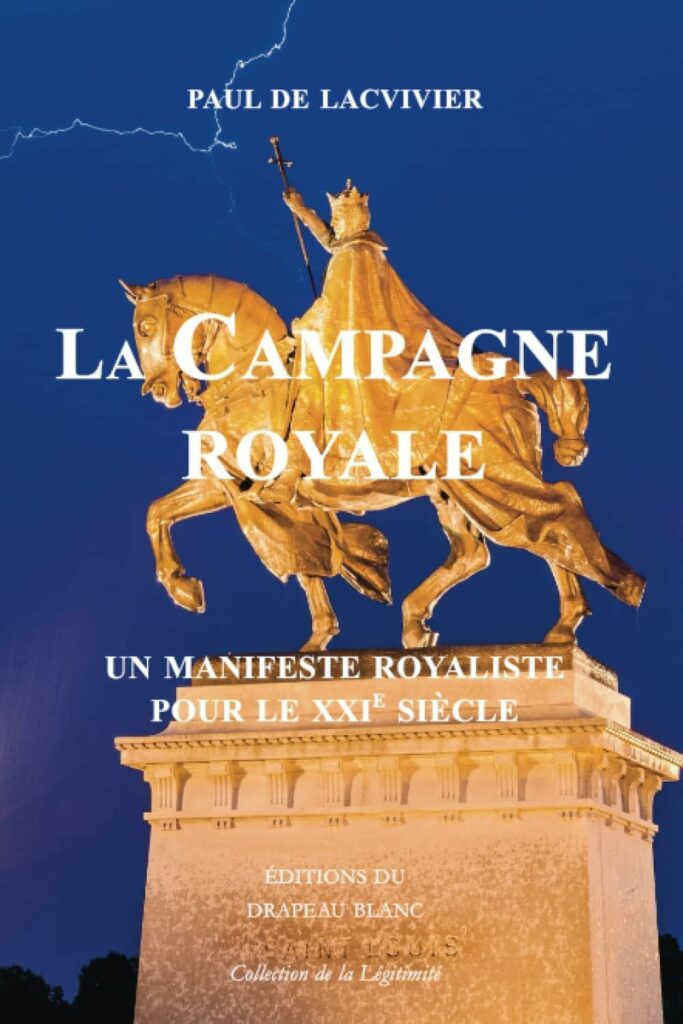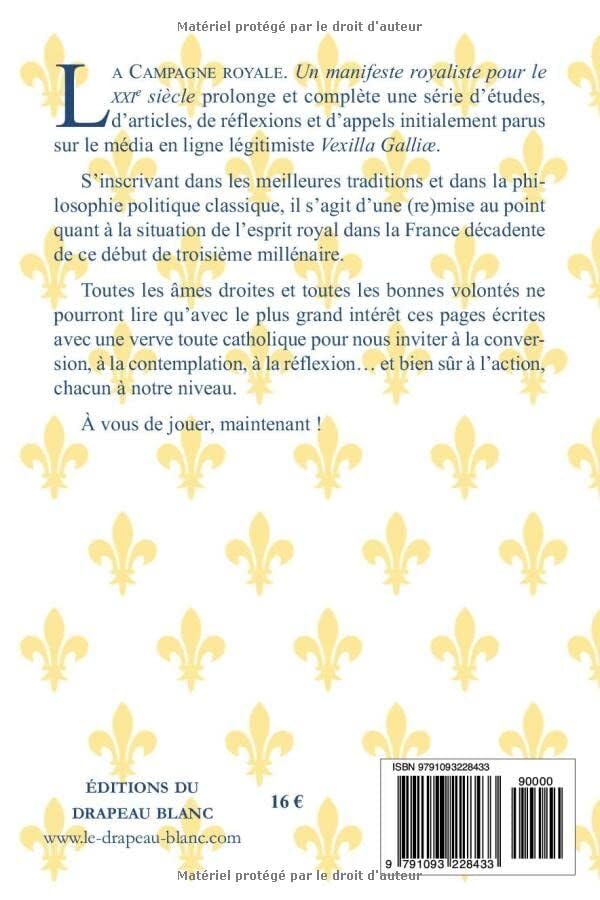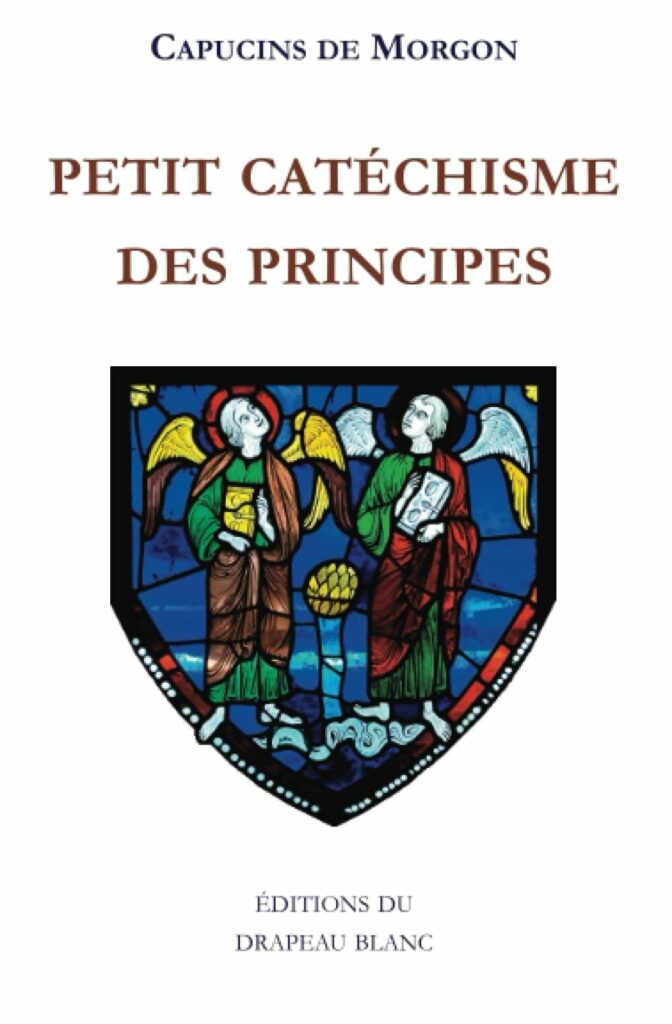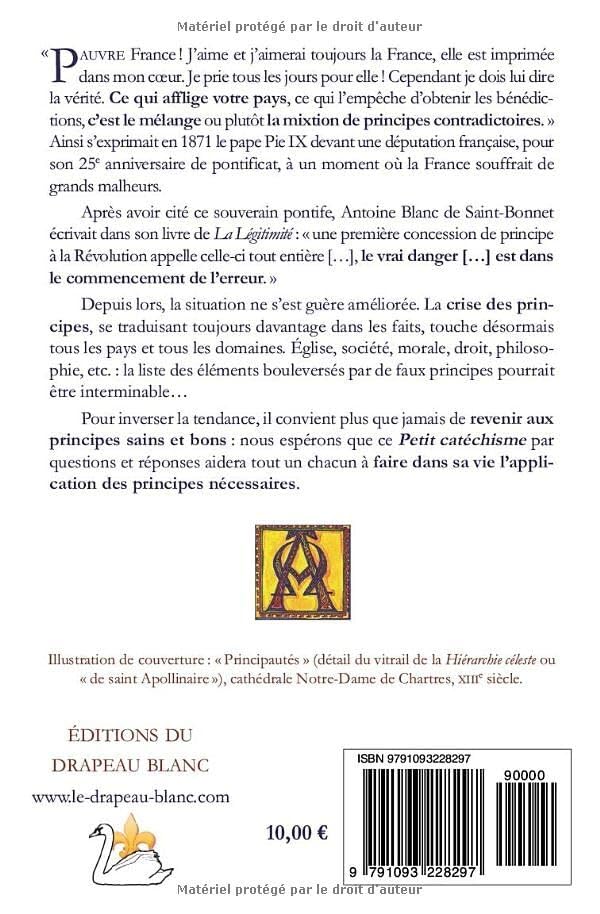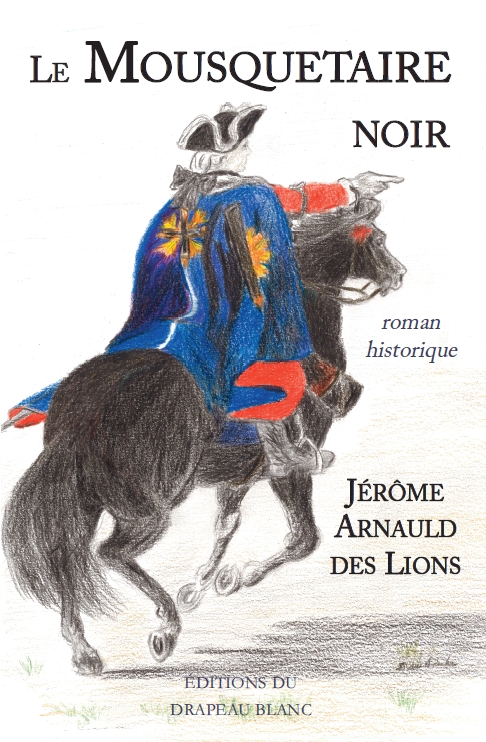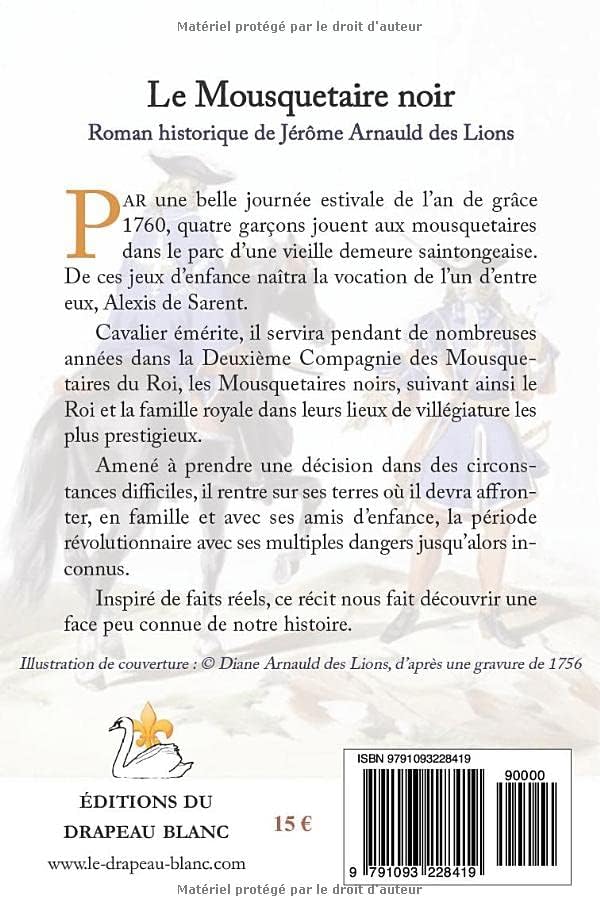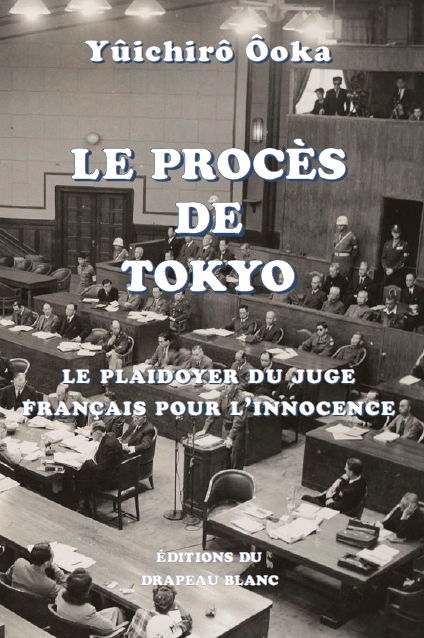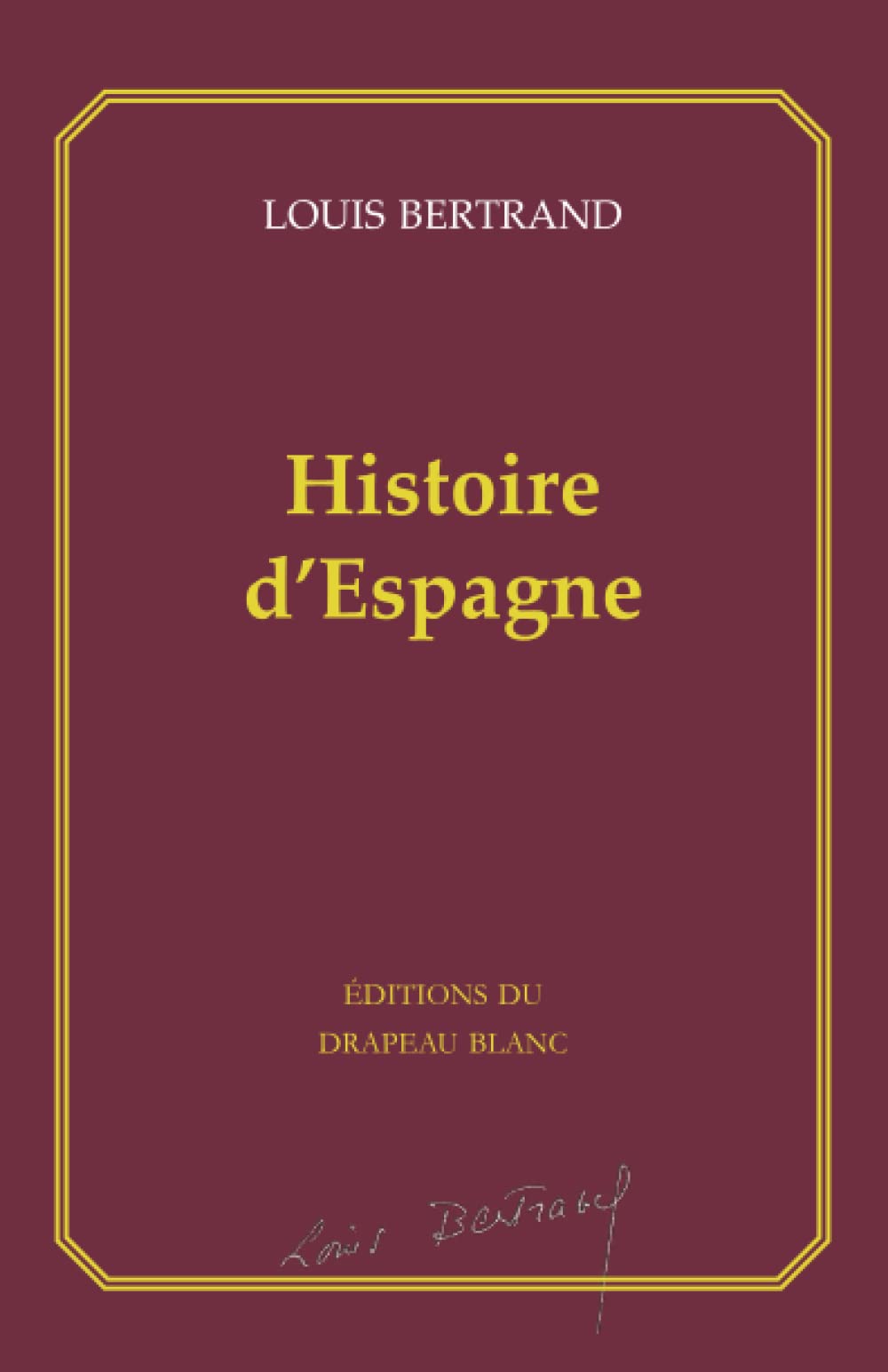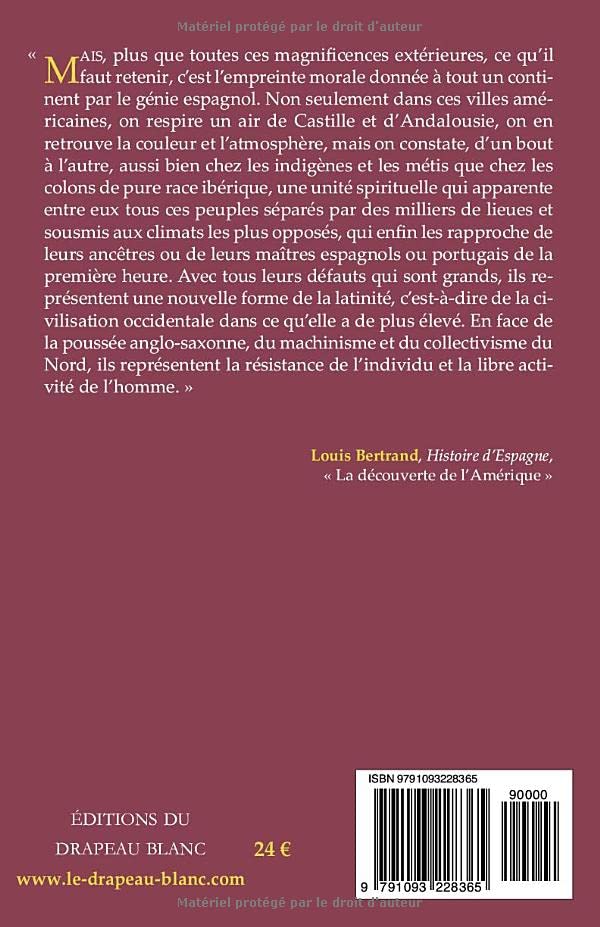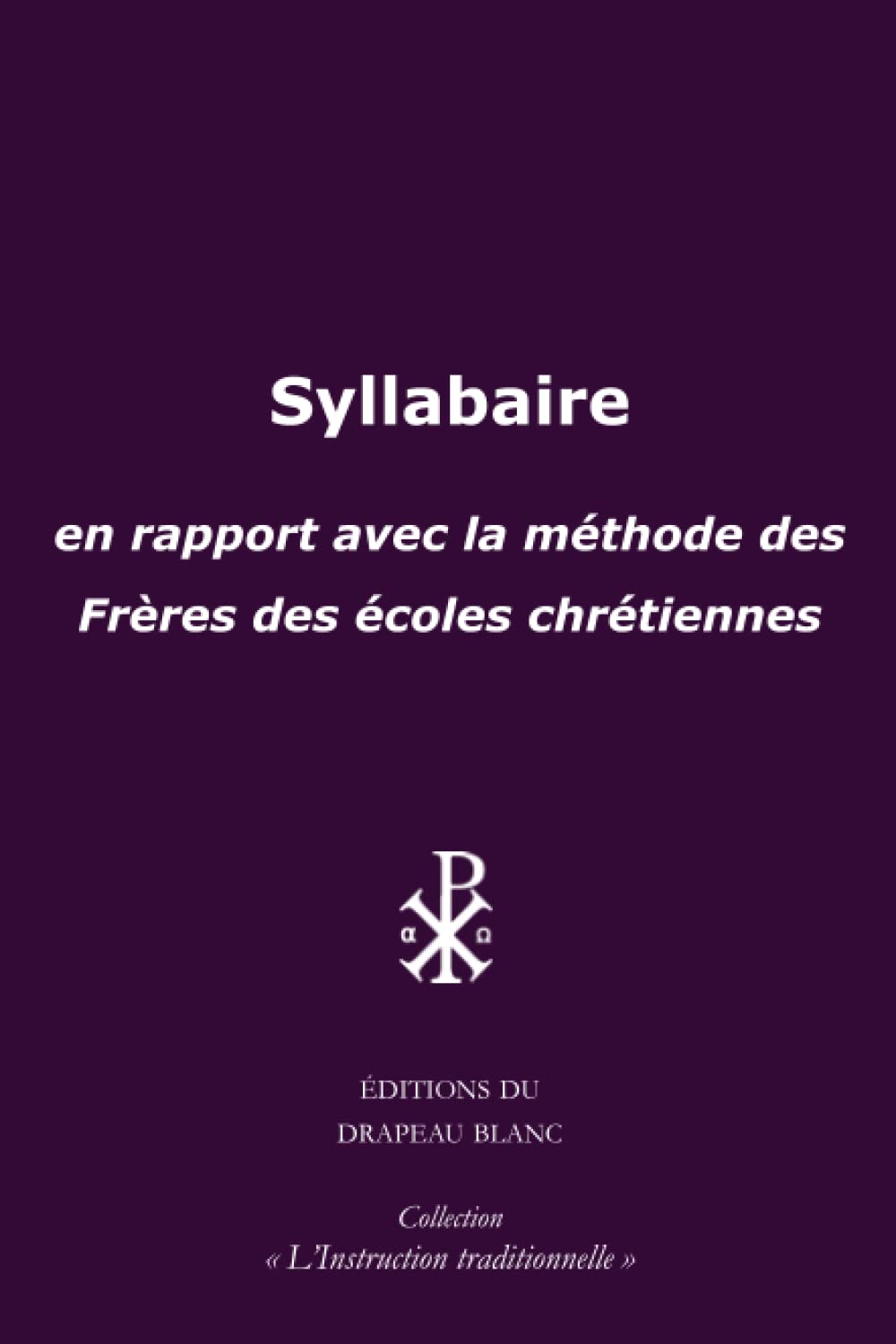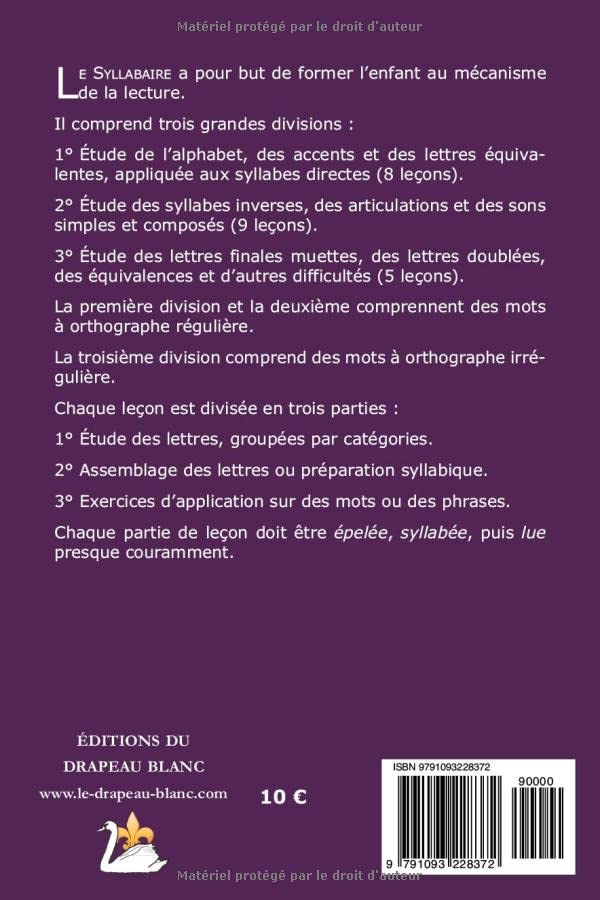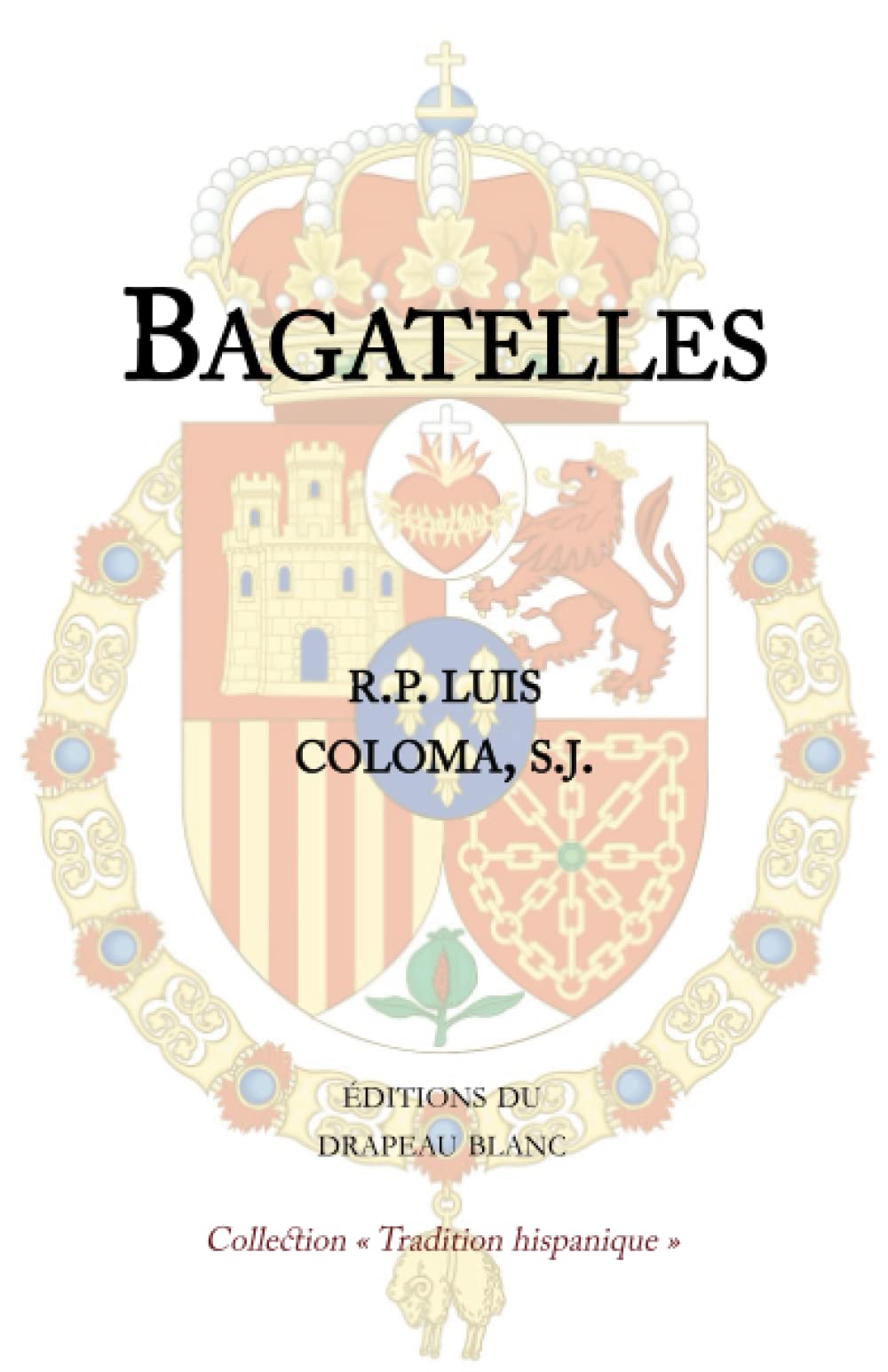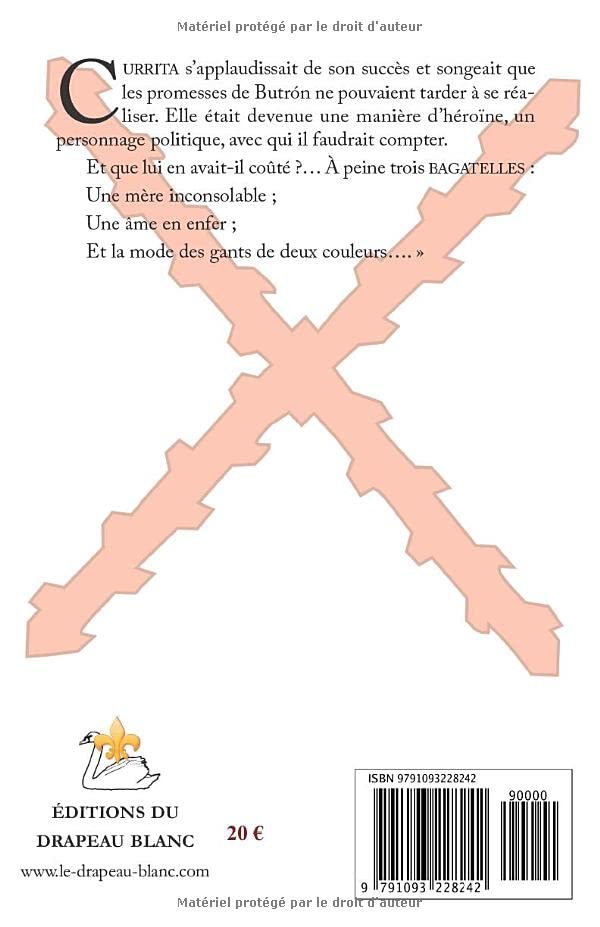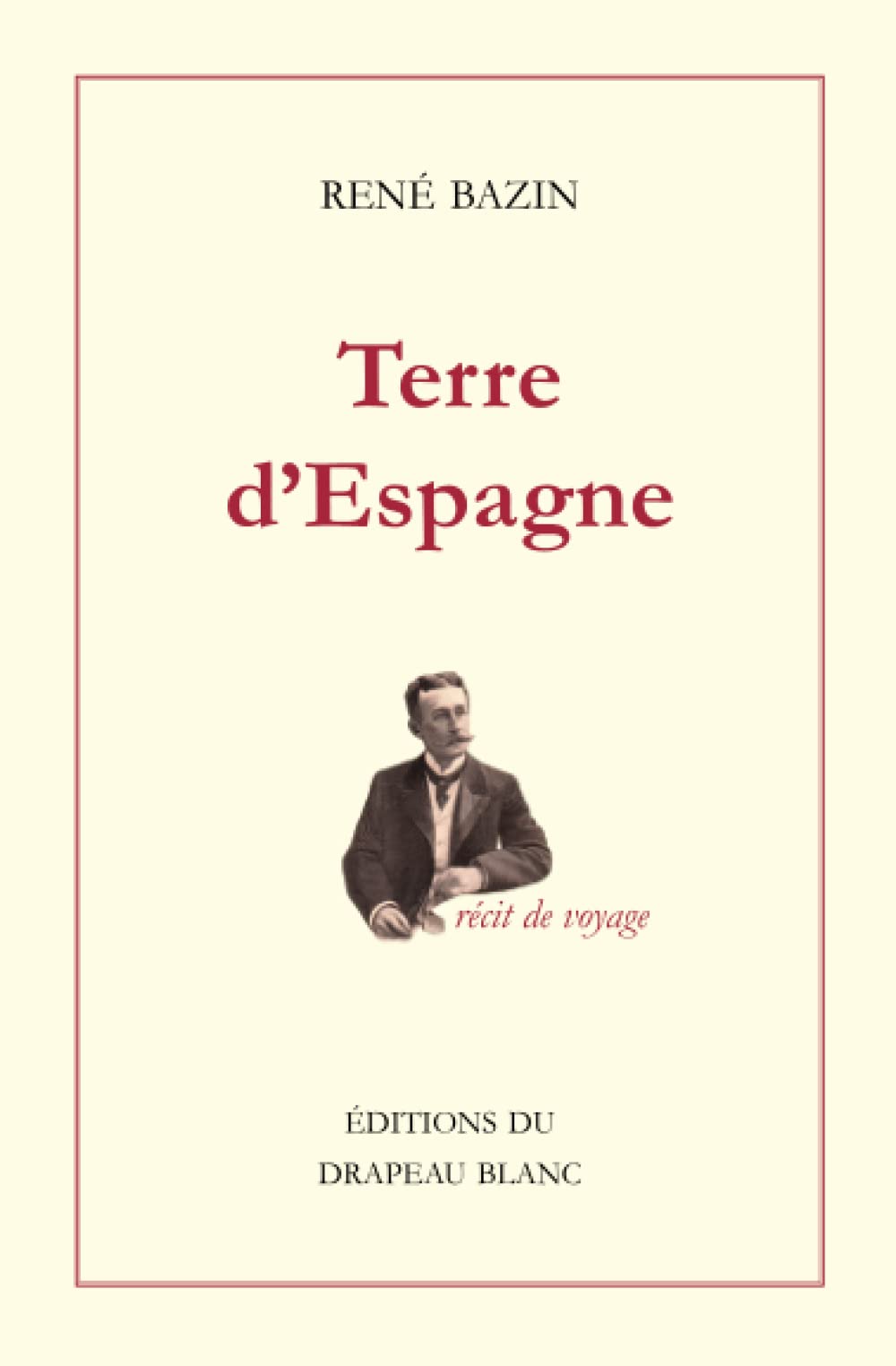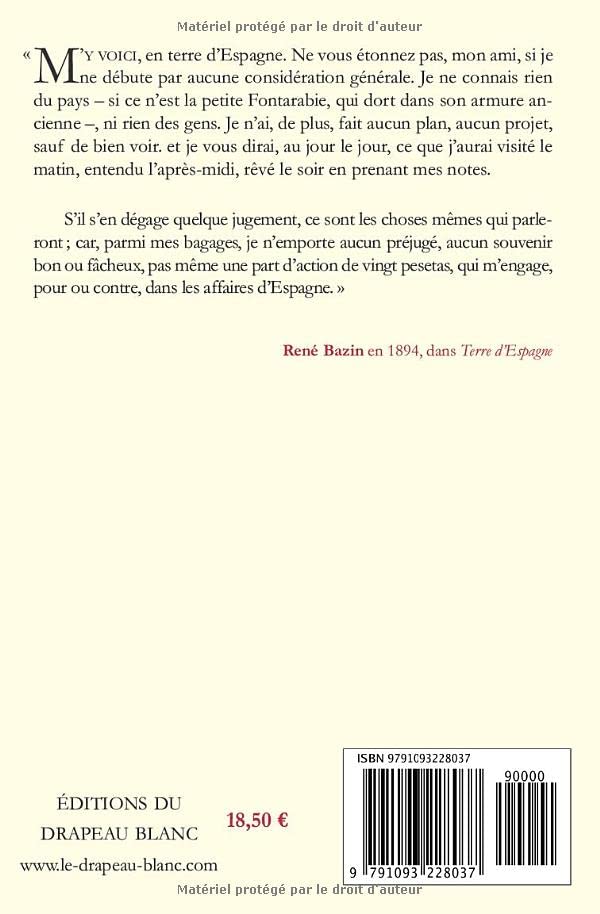Depuis le 11 octobre 2023, le Credo et programme du parti carliste, un véritable document historique rédigé par don Manuel Polo y Peyrolón, est disponible en librairie : n’hésitez plus !
« L’Espagne, pauvre et malheureuse, a besoin […] de quatre régénérations plus encore que du pain dont on se nourrit, car les sociétés et les individus ne vivent pas seulement de pain. Ces quatre régénérations sont : la régénération religieuse, la régénération politique, la régénération sociale et la régénération monarchique. Or, le parti carliste est le seul qui ait la volonté suffisante pour réaliser les quatre régénérations susmentionnées, comme nous le verrons en étudiant la question à ce quadruple point de vue.
« L’Espagne continue de porter un héritage éminent : le titre glorieux de nation catholique par excellence ; mais mérite-t-elle vraiment ce titre de nos jours ? la chose est triste à admettre, mais plus triste encore est la réalité qui nous accable… un siècle de révolution, douce ou féroce, mais toujours antireligieuse, a laissé son empreinte profonde sur la physionomie espagnole, au point de défigurer et de rendre méconnaissable la fille de prédilection de l’Église. Le peuple espagnol, dans son immense majorité, et surtout dans les campagnes, reste catholique grâce à la miséricorde divine ; mais les spectacles d’impiété et d’irréligion sont légion dans les métropoles qui se disent cultivées. »